
L’amour ou rien au Trident | Quand le corps cherche ce que les mots sont incapables d’expliquer
La soirée s’ouvre d’une façon rarement vue au théâtre. Sur scène, avant même la première réplique, la metteuse en scène Mélanie Demers reçoit le prix Molson de la présidente du Conseil des arts du Canada. Longue présentation, remerciements sentis, prise de photos… Une parenthèse solennelle, suspendue, où le public assiste à un moment d’histoire, sans trop savoir si cela fait partie du spectacle ou s’il faudra bientôt changer d’état d’esprit. Puis, quand la salle plonge dans le noir, une fanfare militaire se fait entendre. Personne n’apparaît encore sur scène. On se croirait au bord d’une parade, dans cette seconde étrange où les échos d’une troupe précède son apparition. L’amour ou rien commence comme ça : par un son avant un sens, par un pas avant une direction.
Au centre de la scène, derrière, un drum attend. Laurie Torres arrive, s’installe, y pose les mains, le rythme, la pulsation. Des deux côtés de la scène, des spotlights éteints, comme des promesses encore muettes. Puis, les artistes surgissent. Vêtus de rose, de paillettes, de fourrure, tout droit sortis d’une soirée pop des années 70, quelque part entre la fête et la caricature d’elle-même. Ils bougent de manière désarticulée, presque dérangeante, comme des morts-vivants sans âme, des corps qui voudraient danser mais dont quelque chose, à l’intérieur, refuse encore d’embarquer. Le résultat : un malaise doux, celui qui force à regarder autrement.
Très tôt, une réplique fuse sur le ridicule des containers expédiés pendant les guerres : ravitaillement d’un côté, armes de l’autre. Contradiction assumée. Comme si l’amour, déjà, se faisait rappeler qu’il naît dans des territoires où la logique se perd. Les artistes chantent tout au long de la pièce, par vagues. Doucement parfois. Puis les voix montent, se superposent, s’étirent. Un crescendo fragile, humain, presque tribal, revient d’un chapitre à l’autre. Les 13 chapitres du spectacle se placent un à un, comme des pierres posées sur un chemin qui ne mènent vers nulle part de prévisible. Par moments, Laurie Torres tourne le dos au public, à son instrument, comme pour offrir toute la scène à l’artiste qui s’y dépose. Distance. Violence. Absence. Ces mots prononcés, leurs contours traversent l’espace.
Le chapitre trois porte l’honnêteté comme un fardeau. Sur scène, Fabien Piché tente de dire quelque chose, de transmettre, mais les mots se heurtent à lui. Ils sortent en sursaut, comme arrachés. Un tic, un spasme, une lutte interne. On y voit le combat de quiconque tente d’être vrai dans un monde où l’authenticité tremble au bord des dents.
Au chapitre quatre, les spotlights s’allument. Ariel Charest livre un monologue sur le cunni; l’art, le mot, l’acte. Une réflexion sans détour, tenue dans un langage aussi intelligent que nécessaire. Du plafond, des jets de lumière tombent comme des colonnes divines. Les artistes entonnent un chant presque religieux, sans parole, un souffle collectif qui monte doucement. Puis tout se mélange, les mots surgissent : « le corps en premier, le corps en premier ». Répété, scandé, bousculé. Le corps qu’en a-t-on fait? La représentation durant, leurs micros suivent leurs mouvements, au sol, ils touchent presque le plancher; à genoux, ils flottent plus haut; debout, ils deviennent de véritables totems. La hauteur s’adapte à l’urgence.
Mimo Magri chante. Une voix splendide, chaude, parfois soul, capable de remplir l’espace sans violence. Elle enchaîne des phrases sans lien, un ramassis volontaire de n’importe quoi. Et malgré tout, la voix touche. Comme si, dans la beauté du timbre, le sens devenait accessoire. Comme si, peu importe ce qu’on dit, tant qu’on le chante assez bien, on comprend. Peut-être que les relations fonctionnent ainsi plus souvent qu’on l’admet.
Vient ensuite une scène magnifiquement troublante : Fabien Piché est dans un entre-deux, on ne sait plus s’il danse avec ou s’il poursuit Rachel Amozigh sur scène. Elle bouge sans arrêt, elle bouille presque. Lui répète sans cesse « s’cuse ». En boucle. Avec repentance, impatience, fatigue, amour, détresse, désir. Il chuchote, il crie, il supplie, il reprend son souffle. Rien d’autre que ce mot, et pourtant, tout y est. L’amour. Le manque. La maladresse. Le trop. Le pas assez. Le vouloir. Le ne plus vouloir. Le vouloir encore malgré soi. L’éternelle excuse d’aimer mal.
Une phrase tombe : « faut que les bottines suivent les babines ». Une vérité vieille comme le monde, mais encore là, plus tranchante quand elle tombe dans un spectacle où les corps hurlent ce que les idées refusent d’affronter. Les artistes féminines possèdent toutes des voix superbes. Frannie Holder chante dans une teinte rappelant Tori Amos. On verra passer un tuba, un trombone, des instruments à vent. Joue-t-on vraiment? La frontière reste volontairement floue. Ils sont tous pieds nus, comme pour ne laisser aucun obstacle entre leur corps et le plancher vernis qui, lui aussi, fait partie du spectacle.
Ariel Charest dit aussi : « fais l’amour lentement ». Puis : « tout ne se négocie pas ». Et soudain, l’incapacité humaine à gérer le malheur surgit, brute, sans avertissement. Ariel Charest brille particulièrement tout au long de la pièce. On la voit tantôt tenter de faire partie d’un ensemble qui semble impénétrable, trop différent, trop inaccessible pour elle. Ses monologues sont bouleversant d’humour et de lucidité. Sa présence est extraordinaire. On dirait quelqu’un qui essaie de se fondre dans ce qu’elle aime, comme on tente parfois de se fondre dans ceux qu’on aime.
À leur dernière apparition, les artistes reviennent exactement comme lors de leur première entrée, mais tout a changé. Le rose a disparu. Le noir a tout avalé. Les paillettes, les plumes, les fourrures sont toujours là, mais leurs couleurs ont migré à l’ombre. Le scintillement est devenu obscurité. Leur danse, qui au début ressemblait à celle de morts-vivants délurés, se synchronise maintenant avec rythme. Les gestes sont uniques, désunis, calibrés. Comme si l’amour, celui qui traverse, abime, construit, détruit, mais ne se nomme jamais, les avait finalement moulés dans une même forme. Comme si, pour exister ensemble, il avait fallu s’assombrir.
On quitte la salle avec la sensation étrange d’avoir tout senti, mais de n’avoir rien compris. Et peut-être que c’était là, le point. Parce qu’au fond, de l’amour, rien n’est jamais compris, mais tout est ressenti…
- Artiste(s)
- L'amour ou rien
- Ville(s)
- Québec
- Salle(s)
- Salle Octave-Crémazie (Grand Théâtre de Québec)
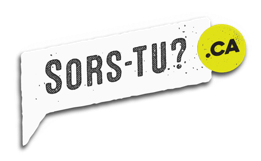

Vos commentaires