
Les Açores de la Trâlée | Le vertige d’exister
Au théâtre Périscope, la scène transformée en nef d’église devient le lieu d’un exorcisme intime. Sous la mise en scène sobre et magnifiquement maîtrisée de Lorraine Côté, Les Açores de la Trâlée déploie le voyage intérieur d’une femme qui cherche à se comprendre à travers les blessures, les amours écorchés et les mots laissés en héritage. Une pièce portée par une seule comédienne, mais dont l’intensité emplit tout l’espace, jusqu’à nous bousculer, parfois trop littéralement.
La salle est coupée en deux, comme si le théâtre lui-même s’était replié sur sa propre fragilité. Le public est entassé, collé, prisonnier d’une proximité dérangeante. Les cuisses se touchent, les coudes s’entrechoquent, et même le souffle de l’autre devient perceptible. Ce malaise physique prépare à ce qui viendra : une immersion totale dans l’intériorité de Mélodie St-Laurent, 28 ans, qui tente de donner un sens à son existence. La lumière vacille, le clavier résonne trop longtemps, la tension monte lentement, presque à contretemps, avant que la parole, enfin, ne prenne le relais.
Sur scène, une femme s’installe derrière un clavier et commence à jouer, longtemps, trop longtemps. Elle ne sera qu’une ombre musicale, une présence qui accompagne sans intervenir. Devant elle, un autel, des cierges, un lutrin, un chemin de croix. Sur l’autel, un livre posé là, qu’on croit d’abord être une Bible. Mais quand Mélodie s’en approche, elle révèle qu’il s’agit en réalité d’un dictionnaire Le Petit Robert. Et d’un sourire désarmant, elle confie que c’est sa Bible à elle. Celle des mots. Celle qui définit, explique, répare. Parce qu’ici, la foi ne passe pas par la prière, mais par le langage.
Elle se présente : Mélodie St-Laurent. Elle a 28 ans. Nous sommes en 2015. Et dès qu’elle ouvre la bouche, on comprend que cette pièce ne sera pas une simple narration, mais une confession poétique. Elle fouille dans son sac à dos, expose ses souvenirs, ses fragments, ses colères. Elle parle de ses ancêtres, de L’homme rapaillé de Gaston Miron, de ce besoin d’appartenance qui s’échappe toujours un peu. Elle dit : « la colère, c’est une manière de reprendre le pouvoir. » Et soudain, tout s’éclaire.
Cette phrase, prononcée presque dans un souffle, devient le pivot du texte. Parce que Les Açores de la Trâlée, c’est ça : une tentative de reprendre le pouvoir sur soi-même, sur les blessures, sur la mémoire. C’est un cri d’émancipation qui se cache derrière l’humour, les références littéraires et les métaphores.
Elle parle aussi d’amour. Celui qui console, celui qui détruit. Jean-Sébastien, cet homme qu’elle fait exister à travers un simple veston, lui dit un jour: « on serait pas en train de tomber amoureux? Parce que l’amour, ça fait souffrir. » Et tout au long du spectacle, l’amour devient une tension constante, entre désir et rejet, tendresse et colère. Chaque « va chier » est une manière d’aimer à distance, de protéger ce qu’il reste d’elle.
Certaines scènes frappent par leur force visuelle. Comme cette image troublante de sa langue fouillant dans un verre transparent, symbole cru d’un baiser échangé avec un ex. Ou cette capote qu’elle transforme en hostie, détournant les codes religieux pour parler de plaisir, de honte, de rédemption. Dans cette église où les cierges côtoient les blessures, tout devient métaphore : l’amour, la foi, la solitude.
La mise en scène de Lorraine Côté soutient ce vertige sans jamais alourdir la charge. Les éléments sont simples : un autel, un lutrin, quelques bougies, un grillage de cage à chat. Mais chaque objet trouve sa résonance, son écho symbolique. Tout semble dépouillé, et pourtant, tout a du sens. C’est cette économie de moyens qui permet au texte d’exister pleinement, d’habiter la scène avec une vérité pure.
Mélodie part pour Paris, nous lit son journal de voyage, évoque Le fabuleux destin d’Amélie Poulin. Elle rêve de New York, elle boit, beaucoup. L’alcool comme pansement, comme anesthésie du vide. Elle raconte sa thérapie, avoir découvert qu’elle est atteinte d’un trouble de personnalité limite. Et, paradoxalement, tout devient plus clair. Parce que cette étiquette, loin de la définir, lui donne enfin une explication à sa tempête intérieure.
Il y a, dans sa manière de se raconter, quelque chose d’universel. On y retrouve nos propres contradictions, nos élans, nos blessures qu’on maquille en humour ou en dérision. « On ne peut pas en vouloir à du monde qui ont souffert », répète-t-elle plus d’une fois. Et chaque fois, cette phrase résonne un peu plus fort, jusqu’à devenir une vérité qu’on voudrait graver quelque part.
La performance de la comédienne est magistrale. Aucune hésitation, aucune faille dans son texte. Elle le connait par cœur, mais surtout, elle le vit. Son énergie, son intensité, sa vulnérabilité maîtrisée forcent l’admiration. C’est une prestation sans filet, sincère, viscérale.
Et pourtant, malgré la beauté du propos, une autre tension se joue dans la salle. L’inconfort physique des spectateurs, la promiscuité extrême, les contacts involontaires, presque intrusifs, finissent par se mêler au malaise de la pièce elle-même. Comme si le théâtre avait voulu que le public ressente, dans sa chair, le poids de cette existence serrée, étouffante, dont on cherche désespérément à se libérer.
La boucle se referme là où tout à commencé : dans l’église du village, devant l’autel où repose toujours le dictionnaire. La femme revient à son point de départ, apaisée ou, du moins, réconciliée. La musique reprend, la lumière s’adoucit. On comprend que le voyage n’était pas vers l’extérieur, mais vers l’intérieur.
Les Açores de la Trâlée, c’est le récit d’une renaissance. Le témoignage d’une femme qui, en apprenant à se nommer, à se comprendre, finit par s’accorder le pardon qu’elle attendait des autres.
Et, au sortir du Périscope, malgré l’inconfort, malgré la promiscuité, on repart un peu plus légers. Comme si, à travers elle, on avait aussi déposé un morceau de notre propre colère.
- Artiste(s)
- Les açores
- Ville(s)
- Québec
- Salle(s)
- Théâtre Périscope
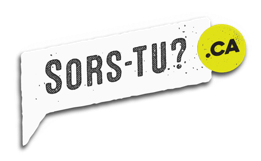





Vos commentaires