
Prix Polaris : Pourquoi les albums francophones ont-ils autant de mal à le remporter? [balado]
Réunis sous le chapiteau de La Jasette des Francos, cinq figures du journalisme musical québécois — Marc-André Mongrain (Sors-tu.ca), Louis-Philippe Labrèche (Le Canal Auditif), Alain Brunet (Pan M 360), Philippe Papineau (Franco Phil, CIBL) et Camille Dehaene (atuvu.ca) — ont engagé une discussion franche et nuancée autour d’une question brûlante : pourquoi les albums francophones québécois sont-ils aussi peu présents dans les sélections du Prix Polaris?
Le point de départ du débat : un constat lucide lancé par Alain Brunet, juré Polaris depuis presque les débuts du prix, sur sa plateforme Pan M 360. Hormis Karkwa, lauréat en 2010, aucun album francophone n’a remporté les honneurs. Une seule victoire en près de vingt éditions, pour une communauté qui représente environ 25 % de la population canadienne, ça représente un déséquilibre flagrant qui soulève des enjeux culturels, linguistiques… et politiques.
Un prix de la « coolitude », pas de la représentativité
Pour Alain Brunet, le Polaris ne récompense pas « le meilleur album canadien », comme son énoncé officiel le suggère. Il s’agit plutôt, selon lui, d’un prix de la « coolitude musicale », à l’image du Mercury Prize au Royaume-Uni : ce sont des œuvres perçues comme avant-gardistes, progressistes ou culturellement « branchées » qui ont la cote. Dans cette logique, des genres comme le jazz, la musique contemporaine, classique ou expérimentale sont d’emblée exclus, tout comme une bonne partie de la production francophone.
Le « fait français » est perçu comme moins cool, moins pertinent culturellement, explique-t-il. Non pas par rejet actif, mais à cause de perceptions sociopolitiques persistantes. « Entre triper sur Lido Pimienta et Antoine Corriveau, on va triper plus sur Lido Pimienta », illustre-t-il, évoquant une fascination pour certaines identités perçues comme plus marginalisées — autochtones, immigrantes, issues de minorités visibles — dans un contexte où la francophonie québécoise ne cadre pas avec cette grille de lecture.
Un point que tous les panélistes ont nuancé ou appuyé : il ne s’agit pas tant d’un problème de compréhension linguistique, mais bien de perception culturelle. Les jurés canadiens anglophones, peu exposés à la réalité culturelle du Québec et souvent influencés par les représentations médiatiques — comme celles associées à la politique provinciale — peuvent inconsciemment porter un regard froid, voire distant, sur la création québécoise francophone.
Philippe Papineau évoque un paradoxe : il a quitté le jury Polaris parce qu’il ne se sentait pas légitime de voter sans connaître à fond la production anglophone. Il questionne toutefois si les jurés anglophones appliquent ce même principe envers la musique francophone, insinuant que l’asymétrie d’écoute est un autre facteur de déséquilibre.
Un système à revoir?
Le modèle du prix Polaris repose sur un processus collégial : plus de 200 jurés issus de la critique musicale, de la radio, des disquaires et d’autres sphères de la scène canadienne échangent et votent sur leurs albums préférés. Pourtant, le groupe reste homogène dans ses tendances stylistiques. Comme l’a résumé Brunet : « Les styles gagnants sont ceux qui cadrent dans le moule ‘néo-Pitchfork’ ».
Louis-Philippe Labrèche souligne que même si des efforts ont été faits par le passé — comme en 2017, lorsque des jurés québécois se sont réunis pour tenter de mieux représenter les artistes d’ici — ces tentatives n’ont pas porté leurs fruits à long terme. La proportion d’albums francophones en sélection demeure faible.
Alors, que faire? Alain Brunet propose une piste claire : créer des catégories. Pour lui, la coexistence d’un seul prix principal nuit à la diversité. Diviser le prix en catégories stylistiques ou linguistiques — jazz, rap, musique électronique, francophone, autochtone — permettrait d’inclure plus d’univers musicaux dans la célébration annuelle. Il souligne que « jamais un rappeur québécois francophone ne gagnera le Polaris tel qu’il est conçu actuellement ».
Mais au-delà des catégories, les intervenants s’accordent : le Polaris est le reflet d’un système, d’une époque, de ses biais et de ses angles morts. La francophonie québécoise n’est pas dans une phase « cool » sur le plan symbolique dans le reste du pays. Elle ne déclenche pas, en ce moment, l’élan d’adhésion émotionnelle et politique que peut susciter une artiste autochtone, immigrante ou racisée.
Une prise de parole nécessaire
Cette discussion, qui se voulait légère et amicale, s’est révélée nécessairement politique et profondément révélatrice. Elle jette la lumière sur des dynamiques d’exclusion involontaires mais structurelles. Elle rappelle aussi que, malgré l’ouverture d’esprit musicale revendiquée par les jurés Polaris, des pans entiers de la production culturelle canadienne — notamment francophone — sont relégués aux marges du palmarès.
En conclusion, les panélistes ne prônent ni le cynisme ni la victimisation. Ils plaident plutôt pour une réflexion lucide et structurée sur l’avenir du Polaris. Car au fond, si ce prix souhaite représenter l’avant-garde musicale du pays, il lui faudra d’abord regarder dans toutes les directions — y compris vers l’est du boulevard Saint-Laurent.
Écoutez le balado complet par ici (la version vidéo sera publiée sous peu) :
- Artiste(s)
- Polaris Music Prize
- Catégorie(s)
- Balado, Chanson, Francophone,
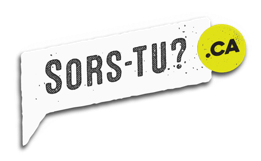

Vos commentaires